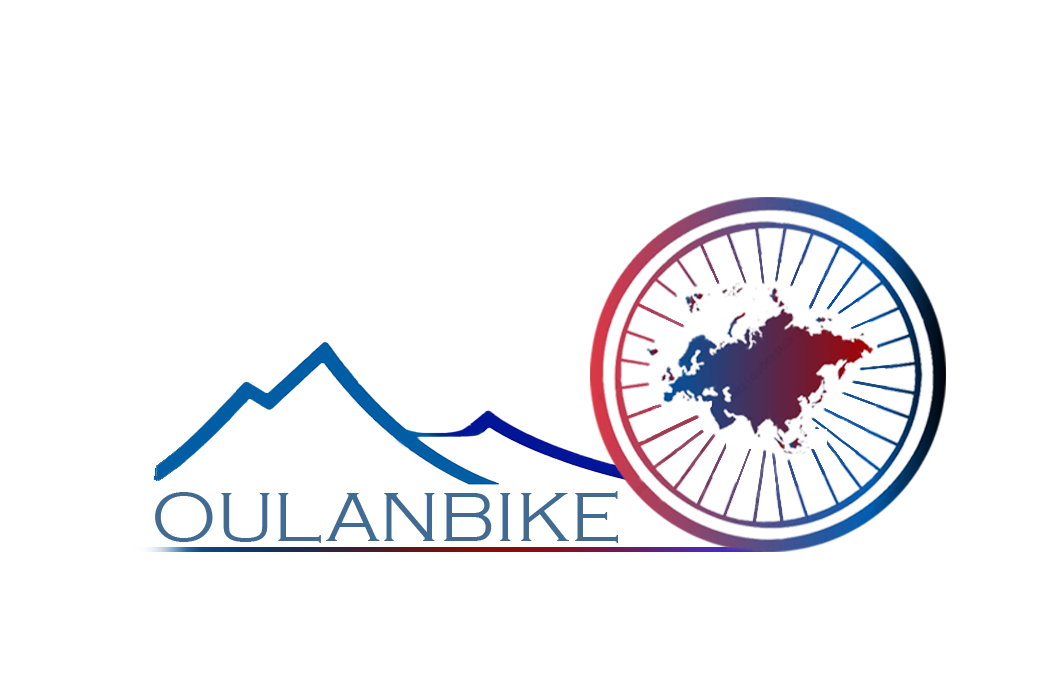Le cyclo-voyageur est-il acteur ou seulement passager des espaces qu’il traverse ? Après six mois de pérégrinations, l’heure est à la rétrospection, au bilan comptable de nos actions, à la recherche du sens de nos braquets. Une question émerge : avons-nous laissé une trace derrière notre roue ? Cela fait un peu état d’âme de l’arrière grand père le soir de son dernier Noël lorsque les yeux perdus dans le feu de cheminé l’idée de sa vie lui revient. Nous avons 23 ans et vous nous direz que nous sommes un peu jeunes. Mais Julien Sorel a été guillotiné à 23 ans et de même, dans quelques jours, notre jolie tête d’aventurier tombera sous le glas des impératifs de rentrée que vous connaissez. On la rangera alors dans le cabinet de curiosité de l’accomplissement personnel et la sortira de temps en temps sur le ton du « Oui, dans ma jeunesse, j’ai fait un grand voyage ». Au Tadjikistan, dans le Pamir, rejeton dans la grande chaine de l’Himalaya, nous avons longé durant une journée le fleuve Pyanj qui devient plus en aval l’Amou-Daria. Ce dernier marque la frontière entre le Tadjikistan et l’Afghanistan. Large parfois seulement d’une dizaine de mètre, nous apercevons distinctement la rive d’en face. Les champs de blé, les maisons en torchis, la piste qui longe la rivière. A ma gauche, les femmes Tadjiks vêtues des habits colorés de l’Asie Centrale, les cheveux détachés, la mine pleine et rayonnante de leurs abricots. A ma droite, des points noirs dans le jaune des blés, sur le beige des porches des maisons, à l’arrière du gris des motos. Des tchadors dans leur art le plus noir. Moment étrange, où sur nos vélos nous passons, sans bruit et indolore, entre ces deux mondes. Un groupe de fille déjà enguirlandé de ses chiffons noirs lance des cailloux dans la rivière. A notre approche, débout et de toute la force de leur poumon, elles lancent un tonitruant « Hello » qui, contrairement à leur cailloux, atteint l’autre rive et nous heurte en pleine face. Cette scène se répète avec les motards de l’autre côté, les bêcheurs de champs, les enfants qui glandent. On joue à se renvoyer la balle des bonjours et des coucous. La frontière d’eau du pauvre Pyanj cédant à l’assaut de ces navettes d’amitié. C’est cela, avec du recul, que nous avons laissé derrière notre roue. Un long sillon de gestes de la main, de haussements de tête, de chapeaux soulevés puis reposés. Nombre de claquements dans la main, de sourires à l’arrachée, de mélopée de Salam et de Sdrastvouié. Certes, nous ne faisions que passer, caresser ces grands espaces. Mais avec ce plus du voyageur à vélo par rapport au voyageur à moteur. Ce privilège de laisser en plus de sa trace de roue et la poussière soulevée par son passage, un peu de lui-même par cette interaction renouvelée avec l’en dehors. En dehors qui, pour un cycliste, n’a de limite que la portée de sa voix. Se dire que, à vélo, j’ai pu interagir, instaurer un contact sonore et visuel avec des individus aussi éloignés de moi que sont les afghans. Se dire que peut-être, ce tableau de quatre points de sacoches bleues, vertes, oranges et grises agitant la main en filant sur la piste restera dans le creux d’une mémoire enfantine. Pas simple passager, pas vraiment acteur, plutôt charpentier éphémère de la mise en relation des peuples, de la connexion orale des nations éloignées. De cette nouvelle esthétique du salut à roulette qui, finalement, sera la seule postérité de notre grand voyage.