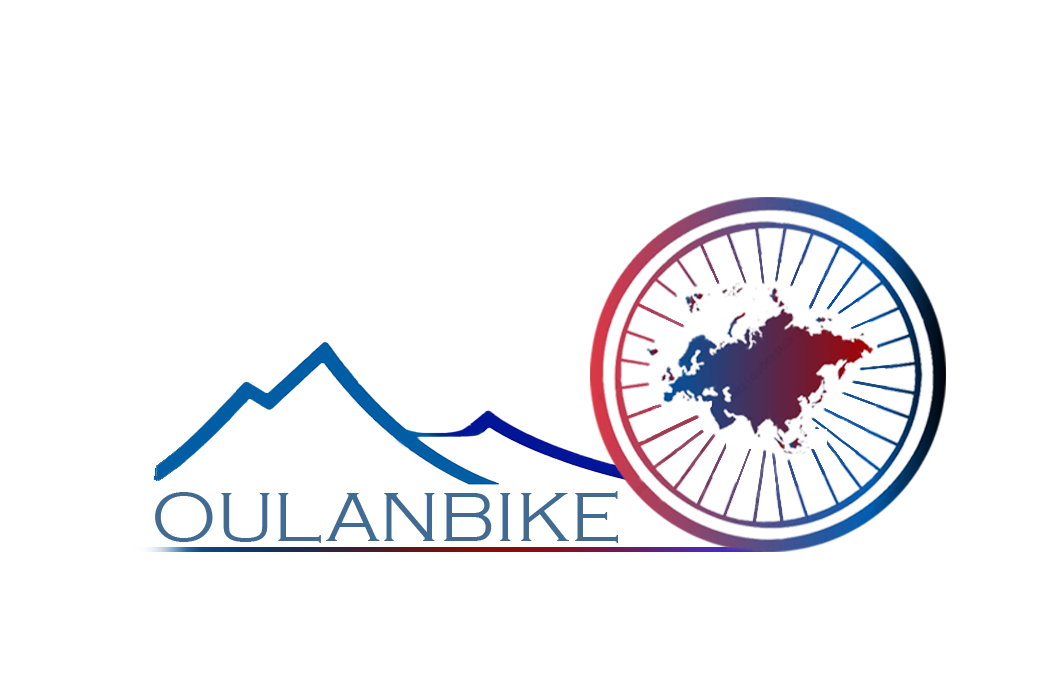Chers amis, il faut finir le pain. En bons chrétiens, nous avons tenté de partager au mieux ce pain béni de l’aventure à travers nos différentes tranches de vie. Tantôt grasse à la mie pleine et savoureuse, parfois plus sèche et mordante tout de croute vêtue, nous espérons qu’elles vous ont plues. Aujourd’hui, ce n’est pas une tranche que nous vous proposons mais un crouton. Certains en raffolent d’autres l’esquivent en le laissant habilement au fond du sachet ou en jetant ses miettes aux pigeons du square de la place Monge. Pour nous, ce n’est plus vraiment une question de gout, davantage une question de fatalité et une certaine antipathie pour le gaspillage. On ne va pas laisser le dernier morceau. Finissons ensemble. Le transsibérien a eu la vertu de la transition. Se retrouver directement catapulté, vélo sous le bras, peau de loup au cou et couteau Ouzbek à la ceinture dans le flot de la faune parisienne du RER B aurait été dure et presque anachronique. Passer d’un bout du monde à l’autre en une poignée d’heure, miracle technique que permet l’avion, aurait rompu notre lien physique avec la distance parcourue. En multipliant par six ou huit notre vitesse habituelle, le train a permis de rompre ce cordon ombilical avec douceur. A déraciner avec amour ces belles plantes vertes que sont les vélos, plantées dans le relief d’un paysage, dans l’aspérité d’un sol, au même titre que l’arbre, le yack, le berger Tadjik. Pendant quatre jours et quatre nuits, nous sommes dans le train qui nous ramène à la maison. Le premier contacte est un peu décevant. On s’imagine des cabines couchettes en bois verni, un lustre au plafond, Agatha Christie au comptoir du wagon bar, Blaise Cendras et sa petite Jehanette. Or la machine est d’un vieux moderne, surement ce à quoi devait ressembler le Paris Lyon des années 80, le restaurant est hors de prix et nos colocataires russes tendent plus vers le gris du soviétique que vers le flamboyant du Prince Bagration. La journée est rythmée par le va et vient au samovar où nous remplissons nos tasses de thé et nos bols de nouilles chinoises instantanées. Néanmoins, le temps passé et la routine des rails installent un certain romantisme. Ces faces qui impriment au premier abord un sentiment désagréable, se patinent au fil des gares jusqu’à incarner un type, une icone : la serveuse aux dents en or qui se remet du rouge à lèvre dans la glace des toilettes, le fumeur névrosé guettant les arrêts, le bellâtre à pantoufle faisant du porte à porte, la provodnitsa en uniforme rouge nous grondant gentiment, le vieux géologue d’Irkoutsk montrant ses ostracites bleus dans sa cabine, la grosse babouchka allant aux toilette vingt fois par jour, le vieil alcoolique slave le nez collé à la vitre du couloir. Une certaine cohérence se dégage de tout ce monde, une impression de film ou de tableau. Les moments les plus délicieux sont le matin et le soir, le réveil et le coucher.Le matin lorsqu’on émerge sans trop savoir où nous sommes. Le roulis du train, le bruit des rails, les forêts de sapin aperçues derrières les rideaux. Si on a l’habitude de se réveiller dans un lieu fixe : ma chambre à la maison, ma suite d’hôtel, ma tente dans la montagne ; ici on se réveille dans le mouvement, dans la valse des heures et des kilomètres. Encore un peu plus proche de l’ouest, du méridien de Greenwich, du fuseau horaire de Paris. Le flou temporel et spatial poussent alors à rester au lit, à y reprendre son livre de la veille ou à rêvasser en regardant le paysage. Où suis-je à présent ? Les bouleaux se sont transformés en grands chênes, le Baïkal a été rempli de champs de blé, les pécheurs ont troqué leur barque contre des tracteurs et la nuit a encore mangé deux heures sur ma montre. Le soir lorsque l’heure de l’apéritif sonne. La longueur de la journée nous a fatigués. On enfile le chapeau, sort le tapis mongol et la peau de loup et préparons notre petit nid de trois mètres carré. Puis on trinque au martini devant la fenêtre, la lumière dorée des fins de journée animant un peu le sale de notre vitre. Souvent les mots d’esprit ne viennent pas et on ne fait que boire avant de rentrer. Là, on ouvre les bouteilles de vin, coupons le fromage et la saucisse. A la deuxième bouteille, les couleurs commencent à nous revenir, les souvenirs aussi. Nous émergeons de notre torpeur, de l’histoire de nos bouquins. On discute alors, fouetté par un coup de sang nouveau. Le paysage défile dans la nuit, les rails grincent, le samovar fume. Nous refaisons le monde pour la dernières fois autour du repas du soir.Voilà pour le transsibérien. Plus qu’un amusement touristique – d’ailleurs pas très amusant en somme – il a été le symbole de notre rapatriement à la maison, de notre retour forcé en occident. Après avoir roulé six mois vers l’est, nous faisons demi-tour, volte face pour revenir plein ouest. On regarde mélancolique défiler la grande Eurasie dans l’autre sens et entendons nos jambes soupirer à ce changement brutal de direction. Un peu comme le petit garçon qu’on ramène de force à la maison on se demande qu’elle a été notre bêtise et s’il n’y a pas le moyen de se faire la malle à la prochaine gare.Nous arrivons à Moscou. Du pays aux mille et trois yourtes, nous passons à la ville aux mille et trois clochets. Arrivé très tôt le matin, nous allons saluer dans l’aube du jour, l’homme rouge du Kremlin qui veille sur nous depuis un moment en Asie Centrale. Salut à Koutousov aussi au musée de la guerre patriotique et hommage aux pauvres grognards ayant atteint la ville sainte sous la neige. Préparation de la carrière de chat diplomate de Manas avec sa remise à un conseiller de l’ambassade de France. L’avion décolle cette nuit pour Paris.