Quand on fait du vélo on devient sensible aux petites choses de la route, aux nombreux détails insignifiants qui, assis sur son moteur à essence, passent souvent inaperçus.
Il y a d’abord le vernis de route, bien connu de nos amis étudiants ingénieurs en travaux public, il est l’objet premier de notre attention. Tantôt plat, lisse et sans bavure comme le parquet d’une piste de bowling, il est une bénédiction pour nos avants bras. Tantôt rugueux et à grains, il fatigue par des vibrations incessantes tout le haut du corps. Le danger réside dans ce qu’on appelle les bourrelets de route. Ces protubérances difformes de béton placées à l’entrée des villages ou en sortie de descente pour faire ralentir les camions sont de véritables mines à faire sauter les vélos. Lâchement camouflés dans le gris du sol, on les aperçoit souvent que trop tard et tel le char de Messala dans Ben Hur, la machine se désosse et on se retrouve tout nu et tout bête avec nos sacoches à terre.
Puis il y a la ville qui constitue un univers routier à part. Dès qu’on y pénètre, on enclenche le bouton « sport » et adoptons une conduite « dynamique ». Le code de la route est aux iraniens ce que les discours de Benoit Hamon sont aujourd’hui pour le français moyen : des bavardages. En Iran, les flots de voiture se déversent à droite et à gauche comme deux longs bras de rivière. Il y a le courant principal, la grosse veine du milieu qu’on prend rapidement, en danseuse, pour forcer légèrement le passage. Une fois dans le gros du courant il faut tenir la ligne. Les éclaboussures de klaxon sont incessantes et par un vigoureux moulinet du bras qu’on appuie, telle une pagaie de kayak, on change de direction. Les rapides dangereux résident dans les nœuds de route comme les ronds-points ou les insertions maladroites. Coude à coude avec nos grands frères de bitume, Goliaths à moteur, on se jette dans le bouillon en serrant les fesses.
C’est technique mais fort en adrénaline. Ressortir entier de ce grand bain de bruit et de pot d’échappement procure une certaine fierté. Cette sensation de s’être mesuré à des éléments plus forts que nous et d’en avoir malgré tout triomphé.
Agile, puissants et beaux, nous nous sommes vite imposés comme les princes de ces routes. A quatre, en ligne, de face ou en formation d’oie sauvage, nous fondons telle une nuée de faucon sur les petits villages et gros bourgs du Zagros. Aux crissements de nos roues, les mères rentrent leurs petits et les commerçants tirent le rideau de leur boutique. A mi-chemin entre le Sphinx ailé et le terrible Warg, nous survolons les routes ou plutôt, nous les avalons. Bénéficiant de l’effet de surprise propre à la race du touriste occidental cyclo-monté, le berger kurde, lor ou azéris n’a que le temps de cligner des yeux que nous sommes déjà loin. Parfois on nous arrête malgré tout, et en grands seigneurs, nous concédons quelques monosyllabes évocatrices sur notre point de départ et d’arrivée : « Salam… go Marivan… no Farsi… Tejaculeh… Bye bye ! ».
Vous l’avez compris : la route est devenue notre terrain de jeu, notre territoire. Ayant déjà conquis un empire de près de 2 500 kilomètres s’étalant d’Istanbul à la frontière irano-irakienne des environs de Kermanshah, nous le garderons fièrement. Gare à celui qui viendra y poser sa roue.
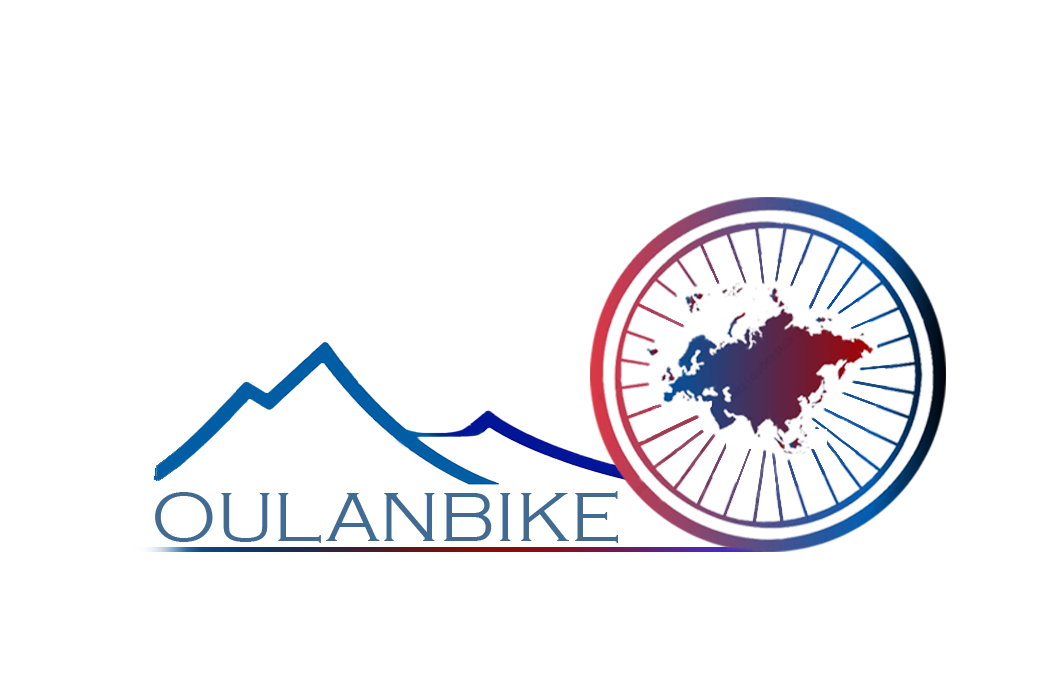

Les commentaires sont fermés.