JOURNAL DE BORD
L’arrivée en terre viking : Keflavik – Reykjavik – Akureyri
« Hi passengers we will land in a few minutes but first look at your right side this beautiful northern lights » C’est seulement dans un vol pour l’Islande qu’on peut rêver d’entendre ce type de phrase. L’atterrissage dans la lueur vert bleue d’une aurore boréale justifie à elle seule tous les aléas d’embarquement low cost Transavia : emballage du vélo, pesé, déballage, remballage, supplément en soute, altercations et sueurs froides.
L’aéroport se situe à Keflavik, ancienne base militaire américaine dont il subsiste quelques bunkers tagués sans grand intérêt. C’est aujourd’hui une large zone industrielle et portuaire. La nationale 40 puis 41 la relie à la capitale Reykjavik. Si la route est relativement peu confortable du fait de l’absence de bandes d’arrêt d’urgence rendant les appels d’air des camions parfois dangereux, elle a le mérite de l’entrée en matière. En effet, la pierre volcanique noire et les effluves du Blue Lagoon au loin plantent le décor, et nous font bien prendre conscience de l’austérité de cette île – désert dont plus de la moitié du territoire est dépourvue de la moindre végétation.
Maison en bois aux couleurs froides, front de mer austère et exposé au vent, boutiques de mode viking et fourrures hors de prix, Reykjavik est la fière capitale de ce pays assez peu peuplé. Elle nous permet de faire les derniers préparatifs avant le grand saut dans le nord et la traversée du désert des Highlands. Nous allons à la pêche aux informations : durée de la traversée, résilience de nos vélos, risques et aléas climatiques… Les avis sont mitigés et souvent peu favorables, on nous prédit la mort par le froid, la soif, la faim, le vent, les cailloux ; on nous recommande souvent la route numéro 1 de l’est longeant la côte plus balisée. Devant notre obstination, nous récoltons quelques « crazy french guys » qui, loin de nous dissuader, alimentent notre petit cinéma collectif et nous poussent encore plus vers cette pampa volcanique.
Nous quittons le luxe de Reykjavik sans regrets un matin en bus. La ville reste une des plus chères au monde, une grande majorité des produits étant importée à prix d’or par transport maritime. Nous garderons comme joyeux souvenirs les quelques essais de bières artisanales, seule expérience du raffinement nordique à portée de nos bourses étudiantes.
Akureyri est la deuxième ville du pays, située au nord ouest du pays. Des petites rangées de maisons bleues et rouges s’étalent le long d’un fjord, au centre de la ville, légèrement en hauteur une belle église luthérienne dont les deux clochets en béton tirent une ligne vers le ciel. Nous sommes agréablement surpris par un festival de jazz qui s’y tient le soir où nous y passons. De grands types, cheveux blonds sur les épaules, yeux bleus, grattent leurs arpèges et déroulent nonchalamment leurs gammes de blues. Nous les écoutons, une pinte à la main, la clope au bec, savourant ces derniers moments de plénitudes et de confort citadin. Demain c’est le départ, le vrai.
La traversée du désert ou «le petit triomphe d’un vélo contre le vent » : Reykjalhid – Askja – Kitusfell Islande, Iceland, Ísland.
On ne vous apprendra rien en vous rappelant que littéralement le nom de ce singulier pays signifie « terre de glace ». En effet, plusieurs calottes glaciaires parsèment l’île, dont la plus grosse le Vatnajökull, véritable monstre de glace, est la deuxième plus grosse d’Europe. Tout ça pour dire que la particularité du désert islandais est que c’est un désert froid, curieux désert donc. Au mois d’août les températures vont de zéro à 10 degrés mais peuvent impliquer un ressenti beaucoup plus bas du fait du vent. Aboutissement de milliers d’année d’activité volcanique, l’étendue que nous nous apprêtons à traverser est un amas de cendre de sables noires, basaltes colorés et coulées de laves figées dans des formes diverses et variées. L’environnement est hostile et dépourvu de la moindre habitation sur près de 400 kilomètres exceptées quelques bases de rangers montant la garde. D’un point de vue historique, les vikings et leur descendants y envoyer leur repris de justice. C’était la prison naturelle et à bas cout du pays, sûrement la première prison écologique de l’Histoire.

Nous décidons de traverser le désert par les pistes F 88, F 910 puis F 28 ce qui nous permettra de passer par le volcan Askja. L’entrée se fait à l’intersection entre la route 1 et la F 88. Soulignons la très belle route depuis Akureyri jusqu’au lac Myavtn. Longer un fjord à vélo est délicieux, avec la montagne à sa droite et la mer à sa gauche, les deux aspirations de l’aventurier sont comblées. Le goudron étant bon et le relief plutôt paravent, on prend plaisir à avaler les kilomètres et à voir le paysage changer. A mi chemin, les majestueuses chutes de Godafoss et leur lot de touristes chinois et américano-retraités. Enfin, l’arrivée sur le lac Myavtn, rouge du soleil couchant et bordé d’une ancienne mer de lave aujourd’hui bien refroidie a aussi son charme.

Après réflexion, nous ne nous en tiendrons pas à une narration purement chronologique de la traversée du désert. Nous avons préféré esquisser quelques tableaux et anecdotes emblématiques qui seront, on l’espère, bien plus distrayantes et représentatives de ce que nous avons vécus.
Précis géographique du Sprengisandur ou « Cinq hobbits au Mordor »
La particularité de ce désert on le rappelle est d’être le fruit de l’activité volcanique. Il est traversé par une longue piste plus ou moins sableuse empruntable seulement l’été par 4×4 ou pour les petits budgets à vélo. Le début de la F 88, est sans grande difficulté car encore très roulant au moins sur les premiers 30 kilomètres. Le paysage est plat et la piste droite, au loin quelques monticules, probables restes de volcans à la gloire éteinte. Le sol est plus proche du gravier que du sable ce qui permet au roues de nos VTC de ne pas trop s’enfoncer. L’astuce est de rouler dans les larges traces des 4×4 passés avant nous, technique proche de celle du ski de fond et plutôt amusante. La première partie du désert jusqu’à Askja est relativement bien irriguée par quelques grands cours d’eau. Cela implique de franchir plusieurs guets. La hauteur d’eau ne dépassant jamais les 30 ou 50 centimètres, et le courant étant rarement démentiel, le principal problème réside dans la température de l’eau. C’est le vélo sur l’épaule et en chantant à tut tête qu’il faut traverser, plutôt deux fois qu’une à cause des sacoches. Puis, il s’agit de réchauffer ses deux panards transformés en bloc de glaçons, parfois sous le regard hilare de quelques touristes descendus de leur char de 4×4. Les plus téméraires tentent la traversée « on the bike », expérience courageuse mais à haut risque, la sentence étant souvent une chaussure trempée pour le reste de la journée.

La deuxième partie du désert qui suit Askja s’ouvre par la piste F 910 réputée comme la piste la plus dure d’Islande et la plus engagée. La prochaine base Nyadalur est à environ 4 jours de vélo d’après les rangers. Après une descente zigzagante dans un enchevêtrement de blocs volcaniques, nous tombons littéralement dans une mer de sable ; phénomène géologique assez unique, qui par la lente érosion des basaltes et des cendres a coincé cette tache de sables noire de 20 miles de large au centre de l’Islande. Seul au loin le glacier du Vatnajökull se dessine dans un mirage blanc. Ici l’immensité est reine et nous écrase. Tels Cinq petites fourmis nous poussons nos vélos et traçons une longue ligne dans cet espace vierge. L’apaisement est total, le vent s’est enfin tût, et la lumière du soleil couchant nous enveloppe. Les membres de l’équipée s’espacent lentement, chacun méditant à sa façon. Un des moments les plus forts du voyage sans aucun doute.
Puis le sable laisse place à d’amples champs de laves solidifiés qui plantent le décor de notre petit cinéma tolkienien. En effet, la forme de ces derniers tantôt statues colossales à l’allure mythologique, tantôt dentelles de soie grise épurées instaurent un labyrinthe interminable à l’ambiance hautement fantastique. Nous nous prenons pour Sam et Frodon, perdus au fond du Mordor, et faisant route vers la montagne du destin.
La suite redonne sa place au relief que nous croyions avoir perdu. Il nous faut passer plusieurs cols jusqu’à Kitusfell, le plus souvent peu roulants, en raison d’énormes bloc de cailloux rendant les descentes dangereuses. Le paysage est encore une fois lunaire et sévère, pas un signe de vie, seulement le vent, la poussière et le soleil. Pas étonnant, que la Nasa ait choisi cet endroit pour entrainer ses astronautes de la première mission Apollo. La grosse bleue nous parait bien loin !
Arrivée à Kistufell, nous apercevons notre première colombe blanche. De larges langues vertes lacèrent le noir du désert en grande coulée à perte de vue, victoire du vivant sur le minérale, de l’eau sur l’aride, du cycliste sur le désert. C’est avec émotion que nous contemplons ces curieuses oasis, promesses d’un retour prochain vers la civilisation.
Les martyres d’Eole ou « the black THIRST’day »
Taper sur votre moteur de recherche « vélo » puis « Islande », un troisième mot apparaîtra bientôt : le « vent ». Nous étions assez dubitatifs sur les réels effets de ce dernier, les messages sur les forums nous paraissant souvent trop alarmants et exagérés. C’est lors d’une journée particulièrement rude de la traversée du désert qui nous avons saisi l’ampleur presque métaphysique de cet élément naturel pour le cycliste.
Au réveil, après Askja, nous sentons que le vent s’est subitement levé. Il nous a d’abord tirés du sommeil en faisant craquer les arceaux et chanter les toiles de la tente. Puis nous avons dû batailler à plusieurs afin de plier et ranger notre habitacle arraché par les bourrasques. Nous avons ensuite pris la route pour la journée la plus éprouvante de tout le périple.
Le vent s’oublie vite lorsqu’on ne l’a pas directement de face. En effet, le vent de dos est une bénédiction du ciel que le cycliste néglige vite, étant souvent tenté d’attribuer sa belle vitesse de croisière à ses simples performances physiques. C’est donc quand le vent nous arrive droit dans le nez qu’on le remarque vraiment. Il est alors impossible d’avancer le pied à l’étrier, il faut pousser le vélo. C’est ce qui nous est arrivé durant toute cette journée. Nous piquions plein sud, or le vent en Islande arrivant habituellement de l’est, il avait viré plein nord. Les bourrasques atteignaient entre les 40 et 50 kilomètres / heures, ce qui a ralentit considérablement notre progression. Nous avons effectué ce jour là pas plus d’une vingtaine de kilomètres en plus de 7 heures. Le vélo lourd de ses sacoches étant devenu un fardeau auquel nous étions enchainés, le moral en a pris un coup. Mais là, où le vent devient le plus dangereux c’est quand il se mêle à son acolyte minéral : le sable ; et à un des besoins du vivant : la soif. En effet, c’est un point d’organisation que nous avons négligé par fanfaronnade ou inconscience et qui a bien faillit nous coûter la fin du voyage. Nous avions en quittant Askja, pris sur les conseils des rangers seulement quelques litres d’eau, en vue de nous ravitailler auprès d’un cours d’eau indiqué à mi-parcours. Le matin, la nonchalance de la traditionnelle tasse de café a finit d’épuiser les dernières réserves. Or nous sous-estimions la durée et les conditions de la journée à venir. Ces immenses étendus de sables hier si apaisantes, attisées par le vent, se lèvent en mini tornades et tempêtes de sables que nous prenons de front. Mal protégés, le sable s’infiltre partout, dans la gorge, le nez, la bouche et nous assèche rapidement. En milieu de journée, nous apercevons du haut d’un monticule le delta accueillant l’eau tant attendue. De nos dernières forces, nous y trainons nos vélos. Cri de désespoir du premier arrivé. Le vent a transformé le sable en une boue jaunâtre, absolument imbuvable. Scène classique d’un album de Lucky Luke, nous nous retrouvons comme les frères daltons à genoux devant le pissou, un peu penauds de ce mauvais tour que le vent nous a joué. Déroute, dispute, désespoir. Il nous reste une dizaine de kilomètre jusqu’à une hypothétique cabane disposant peut-être de réserve d’eau, et la nuit approche. La stratégie est simple : les plus rapides essaient d’atteindre la cabane avant la nuit et de ramener de l’eau aux autres. Rare moment d’incertitude dans l’expédition où l’équipe doit se scinder en deux. La lutte devient alors psychologique et de dimension quasi eschatologique. Eole, dieu du vent, fier maitre des lieux, nous punit pour notre superbe. Nous avons peut-être poussé l’Ubris trop haut. Il nous déséquilibre dans les montés, nous fait chuter dans les descentes et nous aveugle à chaque tournant. Le vélo devient notre croix que nous brandissons en martyres chrétiens de l’ancien temps à ce dieu païen. Nous lui hurlons farouchement des insultes, noms d’oiseau divers et variées, mélopées d’Ave Maria, provocations vaines et désespérées. En retour, il nous assomme de bourrasques cendrées et nous fait pleurer des larmes qu’il assèche aussitôt. Bref, nous perdons la tête. Un de nous n’y voit déjà plus d’un œil, un autre a piqué du nez. C’est alors qu’elle apparue. Coincé au flanc d’une grande colline, la cabane. Dieu soit loué, nous y avons trouvé un jerricane d’eau de secours. Le bon samaritain autrichien : « L’amicale des cyclistes ambulants », « Le collectif des cuisses de feu », « Crazy french bikes » voilà autant de noms pour désigner notre petite société de vagabonds à roulettes. Entreprise fortement élitiste, sa force venait de sa nature hautement hermétique. Cohésion de groupe implique, nous restions entre nous toutes les heures du jour et de la nuit. Les rencontres et discussions avec quelques moldus non cyclo-montés étaient plus que rares. Or nous l’attendions la rencontre, la franche, la sincère. Celle qui donnerait du relief au voyage et du vernis pour nos souvenirs. Un beau voyage ne vaut que s’il y a belle rencontre ! La providence nous la servit sur un plateau, et qui plus est en plein désert ! Replantons le contexte. Nous étions à maintenant deux jours d’Askja, encore tout tremblant du terrible Black THIRST’day de la veille. Eole fatigué ou seulement las de son petit jeu, nous laissait tranquille depuis plusieurs heures si bien que nous recommencions à avancer à vitesse correcte. En fin de journée, ce moment délicieux où le soleil vire ocre et nappe du même reflet or les pierres volcaniques, nous nous apercevons que nous sommes suivis. Loin derrière nous, deux nuages de poussières qui se rapprochent. Horde d’Ouroukail au trot? Bataillon d’orques légers et gobelins en goguette ? Golum et une meute de wargs ? La tension est à son comble et nous redoublons d’énergie. Soudain, au seuil d’une descente, les voilà ! Pas d’échappatoire possible. Nous sommes sur la seule piste à des dizaines de kilomètres à la ronde, il faut faire front. « Do you want some beer ? » La phrase est lapidaire, universelle, irréel. Nous clignions des yeux plusieurs fois, cela fait trois jours que nous n’avons pas croisés âme qui vive dans ce satané désert et voilà qu’on nous propose des bières ?! La voix est chaude et rassurante, un peu rauque, laissant trahir ce qu’il faut de bonhommie et de désinvolture ; elle sort d’une énorme machine de fer montée sur des roues colossales. Deux énormes Monster Truck nous dévisagent. Sorte de camping car de l’extrême, tout droit sortis d’une course de Mad Max, véritables tanks ambulants, nos montures de bicyclette paraissent bien frêles à côté. Comme dans un rêve, on nous tend cinq bières fraiches et un paquet de schnitzel autrichien. Klaxon, flash d’appareil photo, la caravane passe. Nous nous asseyons sur le bord du chemin encore tout étourdis par cette apparition quasi mariale. Pour comprendre cet état d’esprit qui peut sembler un peu extrême, permettons nous une petite digression sur l’imaginaire culinaire du cyclo-voyageur, sujet de thèse d’avenir, qui j’en suis sûr, fera encore couler beaucoup d’encre. Le petit déjeuner, le casse croute du midi et le diner structurent la journée d’un cycliste. Quand on roule, on oublie le temps, l’horloge de l’estomac prends alors le relais. Pour information, il y a quatre stades avant le Dong de la pause déjeuner ou du diner : les prémices de la fringale – peu alarmant, on commence juste à esquisser, colorer, finaliser l’image mentale de notre plat préféré ; l’appétit confirmé – déjà plus chatouilleux, il commence à avoir les premières répercussions physiques : crampes d’estomac, tremblement des avants bras, conversation ralentie… ; la dalle pré- hypoglycémique – le sucre commence sérieusement à manquer, l’esprit prends le relais, buffet à volonté, orgies romaines, spécialités de Maman, un cinéma culinaire d’un raffinement inégalé se mets en place et nous permet de tenir en selle ; L’Hypo – hantise du cycliste, vautour infâme qui le guète en fin de chaque montée, elle signifie la fin du sucre et la mort physique, plus de carburant dans la machine, l’homme tombe et ne se relève pas, spasmes, convulsions, il doit manger ou périr ! Bien sûr, nou

Bien sur nous avons nos techniques. Dès les premiers signes de la phase trois, on peut grignoter une friandise énergétique, qui nous permet de retarder les phases quatre et cinq. Néanmoins, cet expédient qui a ses vertus est aussi une pomme de discorde parmi les cyclistes ; les veilleurs du garde manger commun se faisant un principe de vertu de traquer et démasquer les Hypo trop opportunistes et pas encore assez bavantes. Bref, tout ça pour vous dire que nous étions quelques part entre la phase trois et quatre quand nous avons reçu ces bières. A ce moment précis, l’imaginaire culinaire du cycliste est devenu réalité ce qui tient du petit miracle. Nous retrouvons nos bienfaiteurs le soir à côté d’une modeste cabane pour bivouaquer. Nous dinons avec eux et à coup de grandes rasades de vodka faisons plus ample connaissance. La caravane se compose d’un couple de retraité Kurt et Béa, et d’une famille Alex, sa femme Angelica et le petit Léo. Ils sont partis d’Autriche avec leurs engins puis ont pris le bateau au Danemark. Arrivés en Islande, ils la traversent en long et en travers depuis plusieurs semaines. Complètement autonomes dans leur char d’acier, ils pourraient traverser les Ardennes, écrasant tous les cailloux, faisant qu’une bouché des guets ils semblent indestructibles. Le mérite tient à qu’ils ont fabriqué eux-mêmes leur moyen de locomotion. Membre d’un club de voyage automobile, ils ont d’abord pendant des années rêvé ce voyage dans leur garage le dimanche après midi en bricolant. Kurt, c’est une moustache. Enorme et exubérante à la russe, elle lui donne l’autorité et la bienveillance du patriarche. Deux petits yeux rieurs finissent le tableau de cet homme haut de taille et large d’épaule, vieux beau mais de la vieillesse heureuse, celle de l’aventure et de l’ennui tranquille. Il nous prend sous son aile durant quelques jours. Alex, lui c’est un rictus. Un sourire carnassier mais des yeux qui ne rient jamais. Du genre taciturne, on partage sans dire mot un cigarillo en contemplant la steppe mouillée du glacier, l’immensité lui suffit. C’est ainsi que le lendemain, devant nos mines abattues face au vent et à la pluie qui se lèvent, ils sortent plusieurs longes et attachent nos vélos au cul de leur véhicule. C’est ainsi que nous inaugurons une nouvelle pratique sportive du type cyclo-tractée. A mi chemin entre le ski nautique et le VTT de descente, la difficulté réside dans l’équilibre qu’il faut avoir pour anticiper les accélérations du conducteur, et l’adresse pour éviter les plus gros blocs de pierre. Après quelques mémorables gamelles en descente, ce nouveau sport est avorté dans son œuf, son potentiel olympique nous semblait trop hasardeux. Nous lâchons l’affaire. Cependant, l’entraide ne s’arrête pas là et nos bons amis, ayant réussis à faire taire nos protestations, parviennent à attacher nos vélos sur le toit et à nous pousser de force dans leur antre mécanique. Il nous avance ainsi de 150 kilomètres sur la portion de désert la plus moche jusqu’au Landmanlaugar. Sur la route, nous sommes invités à festoyer à prix d’or dans une jolie taverne nordique. Les liens imprescriptibles de la panse bien remplie contribuent encore à nous rapprocher. Nous faisons désormais partie de la caravane. Si cette rencontre tient une place particulière dans notre mémoire collective de groupe, c’est que le hasard s’en est mêlé plusieurs fois. D’abord la rencontre incongrue dans le désert quand nous n’avions croisé personne pendant plusieurs jours. Puis, l’ultime scène des adieux, tableau d’un lyrisme certain ayant donné la profondeur du sentiment à notre relation. Le dernier jour du voyage avant d’attraper l’avion, nous cherchions une pizzeria afin de clore les festivités. Il pleuvait des cordes, le vent avait repris du service et faisait du zèle. Quel ne fût notre surprise lorsque de la pluie plein les yeux, nous aperçûmes nos deux châteaux ambulants sur un parking. Explosion de joie, grandes tapes dans le dos, prise de nouvelle réciproque. On trinque une dernière fois à la fraternité franco-autrichienne. Edelweiss, Edelweiss, adieu amis, ce fût beau et fort, amitié forgée dans le sable du désert et gravée dans le translucide du glacier, elle sera éternelle ! Venez à Paris nous vous guiderons et vous rendrons au centuple vos milles bontés ! Le Tyrol nous attend ! Et bien soit, nous irons gouter aux douceurs de l’empire de Marie-Louise pour oublier les misères de cette île ingrate ! Nous nous quittons la larme à l’œil. La boucle est bouclée, nous pouvons repartir en paix. Néanmoins, la pizza du soir a un petit goût de trop peu, notre bon samaritain s’est définitivement envolé. Nous nous sentons tout nu.
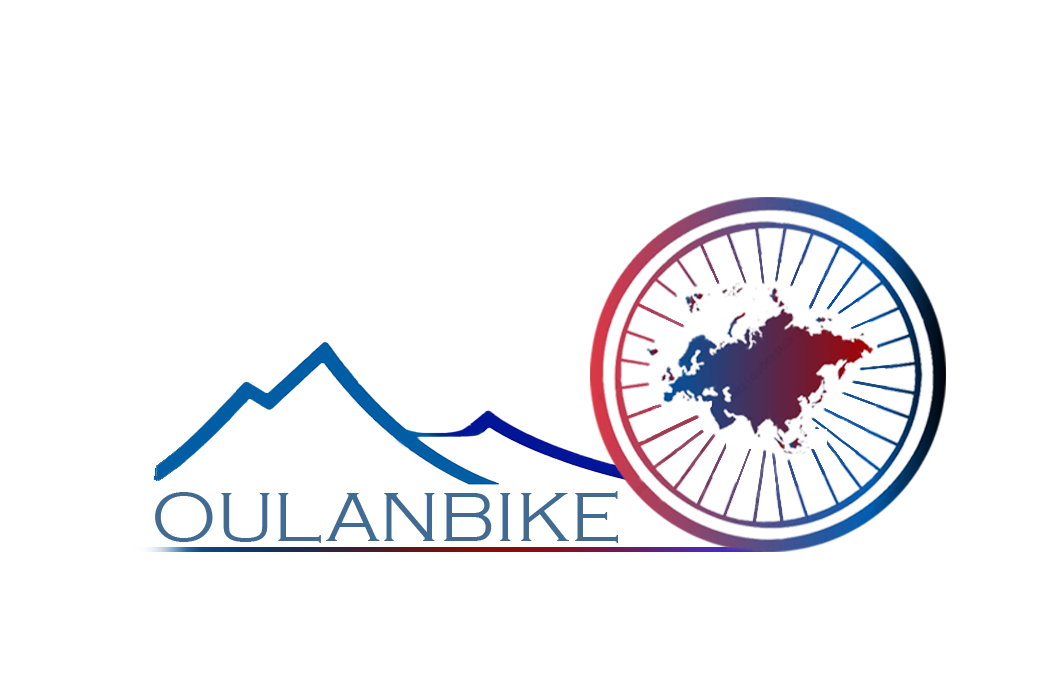

Les commentaires sont fermés.